La pratique du technologue en recherche : doublement gratifiant
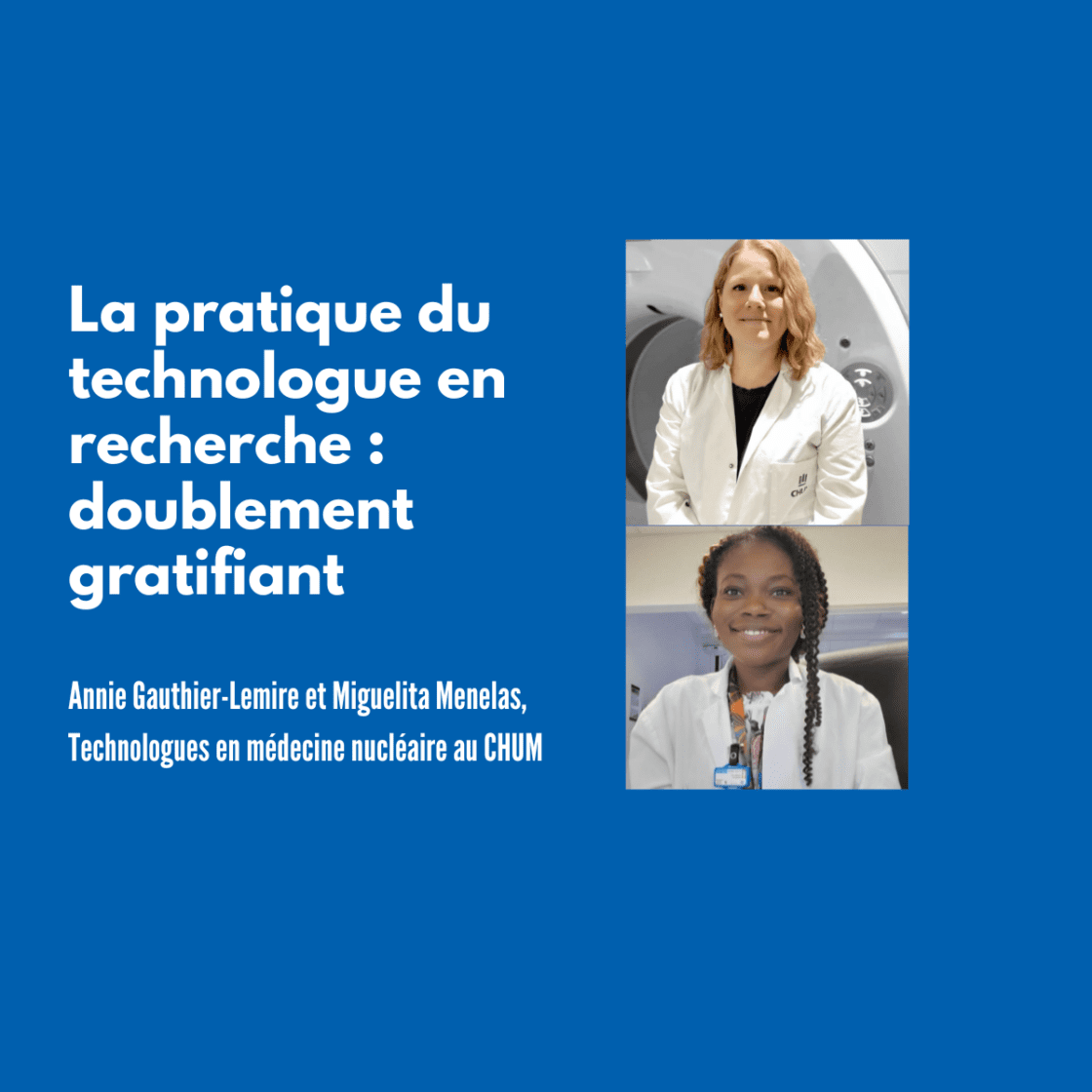
Les projets de recherche font partis du quotidien de Miguelita Menelas et Annie Gauthier-Lemire toutes deux technologues en médecine nucléaire au CHUM. Elles peuvent collaborer simultanément à des dizaines de projets de recherche dans différents secteurs pour plusieurs pathologies, notamment pour le cancer de la prostate. Leurs responsabilités de coordonnatrice technique dans un centre universitaire ont tracé la voie de leur participation à ces multiples projets de recherche.
En quoi consiste votre pratique en lien avec les patients qui font partis de protocoles de recherche?
C’est facilement le quart de notre travail quotidien qui est dédié à la recherche. Nous sommes vraiment les personnes ressources. On doit lire tous les protocoles et mettre en place les protocoles d’acquisition et d’imagerie. À l’attention de nos collègues, on élabore des synthèses et des aide-mémoires pour mettre en mots clairs et simples les protocoles qui font parfois des centaines de pages, afin de faciliter le travail au quotidien. Ça permet aux technologues de se concentrer sur l’information dont ils ont besoin pour les patients à voir cette journée-là et être plus efficace.
On travaille aussi à toute la préparation, la commande de produits et la synchronisation du parcours du patient entre les différents secteurs. Ça demande une bonne logistique parce que nous avons souvent des délais serrés et très précis pour effectuer la prise d’images et suivre le protocole.
Avant même que les équipes recrutent les premiers patients, on est sollicité sur des études de faisabilité. Il y a aussi souvent une organisation commanditaire qui cherche un établissement au Québec ou au Canada pour réaliser leur projet. Ils posent des questions sur comment on fonctionne pour voir s’il peut y avoir un arrimage et qu’on puisse réaliser leur projet ensemble.
Qu’est-ce qui vous allume dans la nature particulière de votre pratique de technologue?
Travailler dans le cadre de protocoles de recherche nous permet de voir d’autres aspects de la médecine nucléaire. Même si c’est exigeant, on est privilégié d’utiliser parfois les premiers produits au Canada et parfois au monde. C’est très gratifiant de savoir qu’on participe à trouver de meilleurs soins pour les patients.
« Un des projets où je suis le plus fière est tout récent et c’est celui à la TEP où on utilise la fluorocholine pour déceler des adénomes parathyroïdiens. Notre taux de succès pour déceler les seuils est très élevé quand l’imagerie conventionnelle n’y parvient pas où qu’il y a divergence entre le scan ou la scintigraphie par exemple. Le mot se passe et on a maintenant des patients qui viennent d’un peu partout parce qu’on est capable de bien aligner l’équipe de chirurgie. Ça fait une énorme différence dans la qualité de vie des patients qui font de l’hypercalcémie et qui ont les os friables.» – Annie
Pourquoi c’est important pour les technologues d’être présents en recherche ?
Si on parle pour la médecine nucléaire, je pense que ça diversifie beaucoup la pratique et notre expertise que de s’impliquer en recherche. Il ne faut pas oublier qu’il y a les médecins, les organisations commanditaires et les équipes de recherche, mais au final, ce sont les technologues qui sont en contact avec le patient à chaque fois pour prendre le temps de verbaliser, d’expliquer. Quand on entend le mot recherche on peut penser à cobaye et ça fait augmenter les craintes. On est là aussi pour rassurer et écouter.
Qu’est-ce que ça prend pour être un bon technologue dans le domaine de la recherche?
La qualité première c’est sans aucun doute l’adaptabilité. Il y a souvent des changements de dernières minutes, surtout les protocoles de phase 1. Il y a beaucoup de documents aussi à compléter. Il faut aussi être calme et proactif.
Le mot de la fin
C’est beaucoup de travail la recherche, mais au bout du compte, la gratification est encore plus grande que la pratique régulière parce qu’en plus de contribuer à soigner le patient, on participe aux avancements et aux nouvelles thérapies qui verront le jour. Qui sait, elles pourraient être disponibles dans 10, 15, ou 20 ans pour nous et pour nos familles.